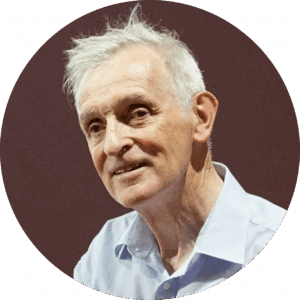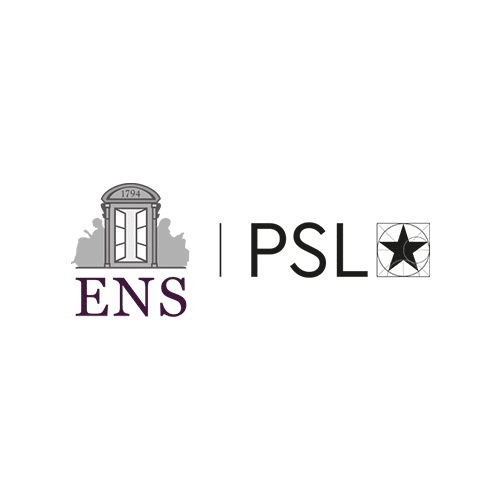Figure emblématique de la recherche sur le climat, Jean Jouzel a livré début 2022 le rapport “Sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique dans l’Enseignement supérieur”, élaboré avec Luc Abbadie et notre groupe de travail. Il revient sur sa réception dans la sphère ESR et évoque les défis pour la communication.
Jean Jouzel paléoclimatologue
Mondialement reconnu pour ses travaux de recherche sur l’évolution du climat, il est actuellement président du conseil scientifique de l’ENS-PSL.
Vous avez remis votre rapport à Frédérique Vidal en février 2022. Un an après, où en sont les établissements ?
Notre feuille de route de départ – faire que 100% d’une promotion soit formée aux enjeux de la transition écologique – est devenue une mission officielle de l’Enseignement supérieur. Ce statut ne change pas la façon dont le rapport est reçu mais il lui confère plus de poids. Dès sa prise de fonction, Sylvie Retailleau nous a appelés pour discuter de la mise en œuvre.
Concernant les établissements, ceux qui ne s’intéressaient pas aux enjeux climatiques ne s’y intéressent pas plus aujourd’hui. Néanmoins, on sait que l’engagement des établissements tend à devenir un critère de choix pour les étudiants. Le fait de signer l’accord de Grenoble (ndlr : document structurant sur les enjeux de transition socio-écologique dans l’ESR présenté lors de la COP2 Étudiante en 2021), par exemple, constitue une démarche intéressante car elle formalise l’engagement d’un établissement. C’est un levier très fort et les communicants ont intérêt à le faire savoir.
Quel va être le rôle du Hcéres (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) dans l’évaluation des établissements sur le plan de la transition écologique ?
La prise en compte par le Hcéres de ce volet sensibilisation est un autre levier qui pourrait pousser les établissements à s’engager. Nous avons rencontré Thierry Coulhon, président du Hcéres, à ce sujet. Pour le prochain cycle d’audit et d’évaluation, la question de la transition et de la façon dont elle est prise en compte par les établissements devrait être examinée.
Par ailleurs, nous estimons que les classements internationaux devraient aussi tenir compte de cet aspect, et ne pas se limiter à compter le nombre de prix Nobel dans les établissements. C’est cela que les étudiants regardent aujourd’hui.
Comment la communication peut-elle accompagner les établissements dans ce changement sans tomber dans la caricature ou le greenwashing ?
Je recommande justement de faire des audits de qualité sérieux sur lesquels la communication pourrait appuyer. Plutôt que de communiquer sur des projets (“on va être neutre en carbone en 2050”), il est préférable de s’appuyer sur les actions déjà menées. Parler de ce qu’on a fait plutôt que de ce qu’on va faire.
Je suis allé dans beaucoup d’établissements. J’ai vu des écoles de commerce se poser la question de la transition écologique tout en continuant à former les étudiants de la même manière. Pousser à la consommation n’est pas favorable à la lutte contre le réchauffement climatique. Comment introduire le terme “sobriété” dans une école de commerce ? Et comment faire quand on est communicant ? C’est une étape difficile qu’il faut passer. On peut trouver un moyen terme et communiquer sur des choses sérieuses, se référer à son bon sens.
Quelles sont vos attentes pour la recherche, en tant que président du conseil scientifique de l’ENS-PSL ? Toutes les disciplines doivent-elles nécessairement être interrogées sous l’angle de la transition écologique ?
Les laboratoires se posent tous la question de l’adéquation entre le type de recherche qu’ils mènent et la transition, notamment les physiciens qui consomment énormément d’énergie. C’est une réflexion mise en avant, y compris dans des domaines comme le mien, sur l’organisation d’expéditions ou la participation à des congrès internationaux. A l’ENS-PSL et ailleurs, on réfléchit à comment l’adapter, à comment mieux prendre en compte la nécessité de la transition dans nos recherches.
En 2022, des étudiants de grandes écoles (AgroParisTech, ENS-PSL…) ont lancé des appels à “bifurquer” et plaidé pour une recherche “impliquée”. Qu’en pensez-vous ?
J’ai été un des parrains de la promotion précédente d’Agroparistech et j’ai vu les étudiants commencer à se poser des questions sur les enseignements. Je souhaite que chacun s’exprime mais il ne faut en aucun cas abandonner la recherche fondamentale. Le point de départ de la recherche n’est pas “on va répondre aux urgences de la société”. Quand on a commencé à travailler sur l’évolution du climat il y a 50 ans, tout le monde se moquait de nous. Tout a coup, on a vu des débats émerger, qui s’appuient sur des travaux de recherche fondamentale. Il est essentiel que celle-ci garde une place majeure dans le système français.
Concernant votre rapport il a beaucoup été question du volet formation au développement durable, beaucoup moins de votre recommandation d’un “nouvel apport massif de financements des projets immobiliers de l’Enseignement supérieur”. Est-ce que les financements vont être à la hauteur des ambitions ?
Nous sommes restés sur le volet formation sans aborder le volet immobilier. Est-ce que les financements seront à la hauteur ? Je n’ai pas de réponse, c’est tout le problème. D’autant plus qu’à la question des financements s’ajoute celle de la création de postes d’ingénieurs pédagogiques, indispensable pour sensibiliser et former.
Cet article est issu de notre #ComESR2023. Exclusivement disponible sous format papier, vous pouvez encore le commander !