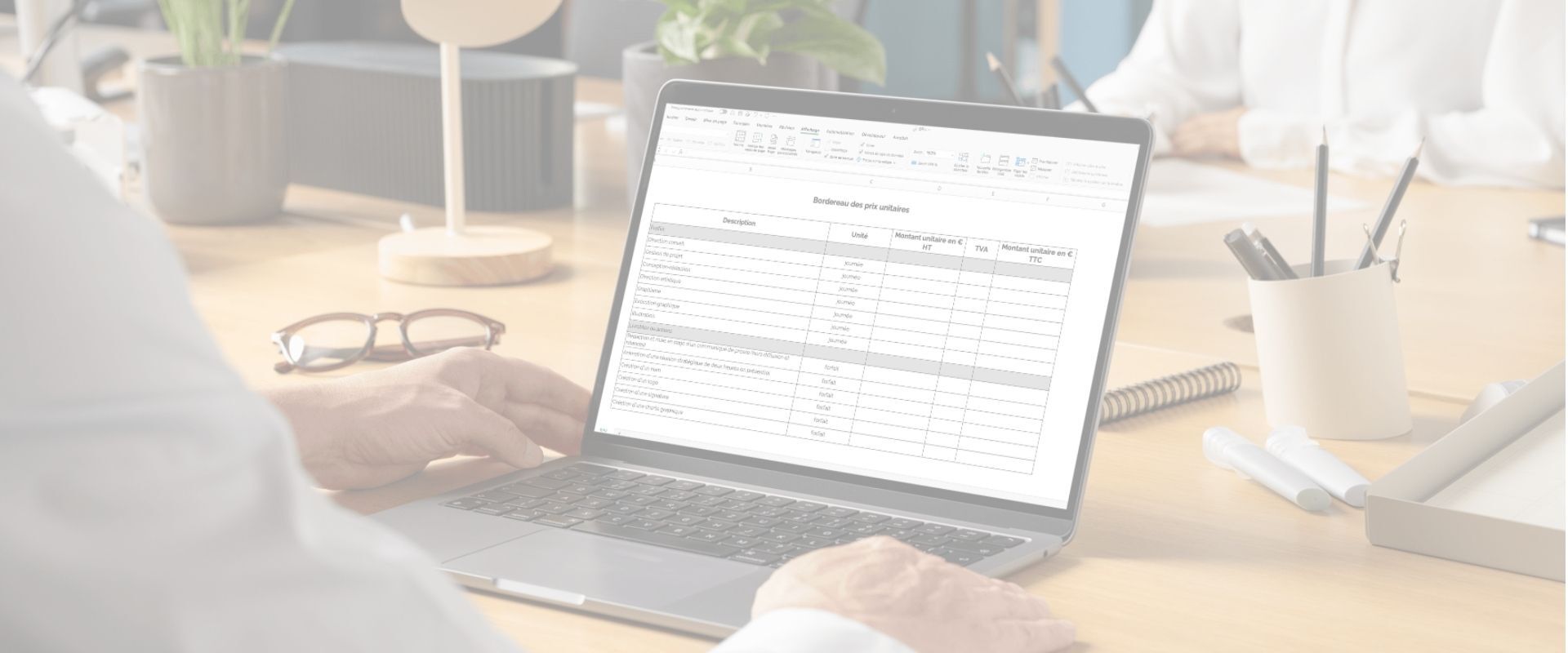Le 12 mars 2024, Sciences Po Paris se retrouve sur le devant de la scène. Alors que ses étudiants s’engagent pour dénoncer le conflit israélo-palestinien, l’Institut est accusée d’antisémitisme. Comment cette institution parvient-elle à maintenir sa réputation, particulièrement lorsque la presse, les médias et les politiques décident de traiter le sujet ? Marie Jamelin, cheffe de projet communication à l’agence et étudiante en Master à Audencia, a analysé pour nous les différentes séquences de cette crise et ses conséquences.
La liberté d’expression au sein des universités : à qui s’adresse-t-elle ?
Face aux crises politiques qui se succèdent, les étudiants prennent la parole sur les conflits qui bouleversent le monde depuis plusieurs années. Conscients que ces derniers occupent une place centrale dans la réputation d’une université, il est pertinent de s’interroger sur la manière dont ces établissements se positionnent en période de crise et comment elles adaptent leur communication.
Si l’on s’en tient à un raisonnement purement juridique, une université publique est un service public, et doit donc rester une institution neutre, placée sous le devoir de « réserve institutionnelle », ce qui limite son expression. Cependant, au sein même de l’établissement, les étudiants sont libres de s’exprimer1 sur des sujets de société et peuvent, sous autorisation de l’administration, organiser des conférences thématiques, à condition que celles-ci ne présentent aucun risque de troubles à l’ordre public. Mais en réalité, ce « principe de neutralité » est bien plus ambigu.
Prenons le cas des enseignants-chercheurs. Considérés comme des fonctionnaires d’État, ils devraient en principe être soumis aux devoirs de neutralité. Pourtant, lorsqu’ils exercent leurs missions d’enseignement et de recherche, ils bénéficient d’une totale liberté d’expression, sous réserve des principes de tolérance et d’objectivité. Ils sont donc indépendants, ce qui leur permet de se présenter à des élections tout en exerçant leurs missions académiques. Mais le bénéfice de ces droits s’étend également aux présidents d’universités. Ces derniers sont autorisés à exprimer des prises de position publiques, notamment politiques. Toutefois, cette liberté d’expression doit demeurer personnelle, et ne doit pas engager l’image de l’institution. Mais que se passe-t-il lorsque un président d’université choisit de prendre position publiquement sur un sujet politique ? De par son rôle institutionnel, il sera inévitablement perçu comme représentant de son établissement. Il est donc essentiel qu’il précise que sa prise de position est strictement personnelle et ne concerne que lui-même. Cependant, cette distinction demeure délicate, car les universités restent des lieux de débats et d’échanges. Les différentes parties prenantes internes et externes, qu’il s’agisse des étudiants, des enseignants-chercheurs, de la présidence, des médias ou des politiques, influencent considérablement l’image d’une université.
Une gouvernance fragilisée
Revenons sur le cas récent de Sciences Po Paris. L’établissement a connu une année 2024 agitée, marquée par une gouvernance instable et des mouvements étudiants contestés par certains, mais soutenus par d’autres. En janvier 2024, Mathias Vicherat, ancien directeur de Sciences Po, fait son retour après une période de mise en retrait, à la suite de sa garde à vue pour violences conjugales survenue le 3 décembre 2023. L’Union Étudiante de Sciences Po s’y oppose fermement et plusieurs blocus sont organisés dans l’ensemble des IEP de France. Finalement, Mathias Vicherat remet sa démission le 13 mars 2024, après avoir appris son renvoi devant le tribunal correctionnel.
Un mouvement de contestation international sur les campus
Au même moment, le 12 mars 2024, un groupe d’étudiants organise une conférence pour la Palestine dans l’amphithéâtre Boutmy, sans autorisation de l’administration, alors que le lieu devait initialement être occupé pour un cours.
Sciences Po accusée d’antisémitisme
Une étudiante se voit refuser l’entrée car elle aurait, auparavant, tenu des propos radicaux contre la cause palestinienne et filmé certains étudiants de manière ciblée. Plusieurs étudiants de l’UEJF appellent à l’antisémitisme, l’étudiante étant de confession juive et cette histoire prend alors une ampleur médiatique considérable.
Un maelstrom médiatique
La presse s’en mêle2, et tandis que certains font preuve de prudence dans l’orientation de leurs titres, d’autres n’hésitent pas à prendre position, sans réelle véracité des faits. C’est également l’occasion pour les politiques de se livrer à une bataille des partis, dans une optique d’anticipation des élections à venir. Alors que la présidente de la FNSP, Laurence Bertrand Dorléac, s’est exprimée devant la commission culture et éducation du Sénat le 21 mars 2024, pour déclarer que « l’intolérance et l’antisémitisme n’ont pas leur place au sein de l’établissement », elle expliquait également, lors de son passage chez France Inter le 18 mars 2024 : « Depuis les événements du 12 mars, l’institution que je préside est en proie à des accusations injustes et blessantes, injustes parce qu’elles reposent sur des informations généralement incomplètes, incertaines, voire fallacieuses ». Face à cet événement, on aurait pu penser que la réputation de Sciences Po allait en prendre un coup. Et pourtant, cet incident a surtout permis à l’établissement de faire une nouvelle fois parler de lui et de se retrouver sous les feux des projecteurs. C’est à chacun de garder un esprit ouvert et un regard critique sur ce qui se passe, de prendre avec des pincettes ce qui se dit dans les médias et chez les politiques.
Une réputation mêlant plusieurs acteurs
Au terme de cette réflexion, on comprend que la réputation d’un établissement se construit et évolue selon plusieurs facteurs : ses étudiants, qui sont l’emblème même de l’université et ses porte-paroles directs. Ils incarnent la liberté de penser, la liberté d’expression, et un engagement fort envers l’établissement. On ne pourra jamais empêcher ces derniers de s’exprimer sur ce qui se passe dans le monde, d’autant plus lorsque leurs études se concentrent sur les sciences humaines, sociales et politiques. La sphère médiatique fait quant à elle rarement preuve de neutralité, étant elle-même influencée par des forces politiques. On le sait, les personnalités publiques jouent un rôle important dans la prolifération d’information, mais surtout de la désinformation. Enfin, l’organisation interne de l’université, en particulier sa présidence, contribue, elle aussi, à la réputation de l’établissement. Les prises de position officielles, par la voix de ses dirigeants, engagent implicitement celles de son institution.
Que reste-t-il de cette crise ?
Presque un an plus tard, quel bilan peut-on tirer de cette affaire ? Sur le plan interne, Sciences Po a subi certaines conséquences, marqué notamment par le retrait de plusieurs donateurs,3 et par des tensions au sein de la communauté étudiante. Pour autant, malgré un engouement médiatique, ayant surtout profité aux politiques et aux journalistes pour alimenter leurs couvertures, Sciences Po continue de défendre l’image d’un établissement sensible face aux crises qui bouleversent le monde. On retient donc de cette histoire que, malgré les nombreuses crises traversées par l’établissement, cette dernière continue d’attirer chaque année davantage d’étudiants, comme le montre un article du Figaro Étudiant, qui annonçait en septembre 2024 plus de 14 322 candidatures pour une entrée en première année contre 12 000 en 2022. Ce sont aussi ces événements qui permettent aux institutions de continuer à exister.
- Code de l’éducation, article L.811-1, second alinéa : « Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. ». ↩︎
- Le Monde, « Sciences Po : les réactions politiques se multiplient après une mobilisation propalestinienne controversée », 14 mars 2024, https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/03/14/sciences-po-paris-les-reactions-politiques-se-multiplient-apres-la-controverse-autour-de-l-organisation-d-une-mobilisation-propalestinienne_6222001_823448.html
Le Parisien, « « Toi, tu rentres pas ! » : le témoignage de l’étudiante de Sciences Po refoulée d’un amphi mardi », 13 mars 2024, https://www.leparisien.fr/societe/toi-tu-rentres-pas-le-temoignage-de-letudiante-de-sciences-po-refoulee-dun-amphi-mardi-13-03-2024-FWN4I4QN5ZCM7KGHJBPXXPGUVM.php
↩︎ - Valérie Pécresse suspend provisoirement les financements destinés à Sciences Po, 29 avril 2024.
Suspension immédiate de la bourse doctorale Jean-Paul Fitoussi par sa famille, 2 mai 2024.
Financement suspendu (2,3M) de Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, 21 juin 2024..
↩︎